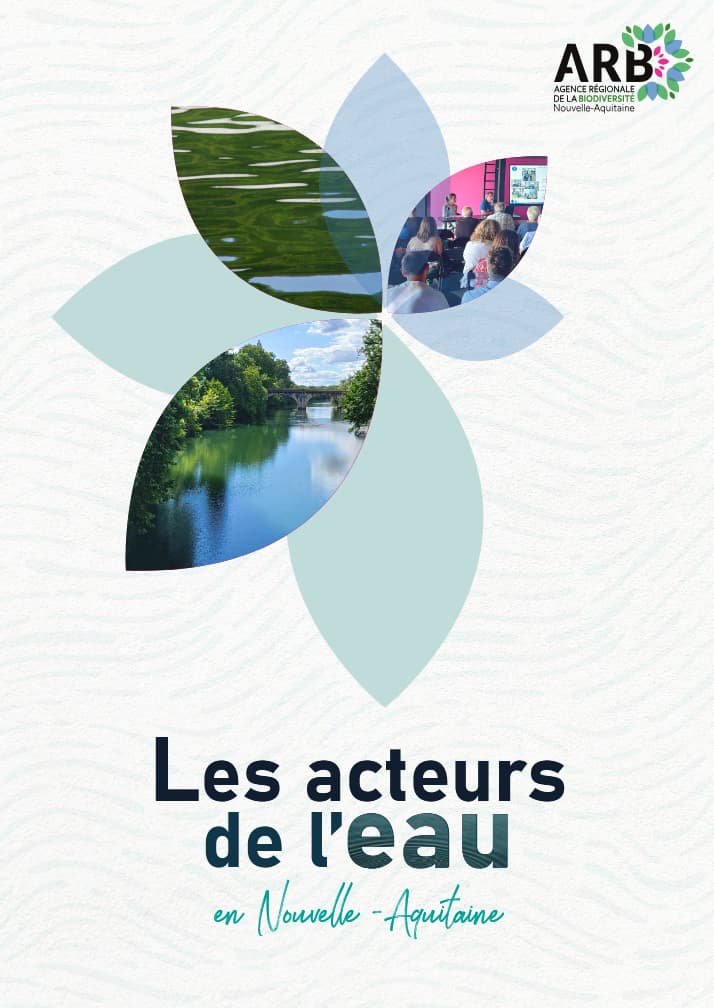Projet de recherche RESTOR
MULTI-USAGES, SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE, ZONES HUMIDES
2025 | NOTICE, PROJET DE RECHERCHE
Contexte
La disparition du castor et les rectifications agricoles ont amené les rivières à se déconnecter de leurs plaines alluviales, cruciales pour réguler crues, sécheresse, inondations, séquestration du carbone, qualité de l’eau et biodiversité. L’hydrologie régénérative permet de pallier cette dégradation des cours d’eau. Une des techniques “low-tech” de régénération hydrologique s’inspire du castor et a été développée aux États-Unis. Elle commence à créer de l’intérêt parmi les gestionnaires de milieux rivières français par l’opportunité qu’elle présente en matière de solutions fondées sur la nature à moindre coût. Or, prendre soin des rivières relève autant de choix techniques que politiques pour co-créer ce qui est désirable pour les multiples usagers. Cela implique de repenser le type de dialogue nécessaire à une gouvernance plus inclusive basée sur des savoirs variés humains et non-humains. De plus, vu l’état massivement dégradé des rivières françaises, la régénération des milieux rivières appelle une évolution culturelle qui emporte la mobilisation des citoyennes et citoyens pour prendre soin de leurs cours d’eau. C’est pour mieux définir et comprendre le rôle des citoyens dans ce mouvement low-tech que le projet de recherche RESTOR a émergé.
Méthode
RESTOR s’inscrit dans une recherche-action participative (RAP) qui s’appuie sur la mise en œuvre citoyenne de chantiers de régénération low-tech de cours d’eau fondée sur les processus naturels, aka la “médecine castor”. L’approche RAP implique un ancrage épistémologique pragmatique qui contribue à mieux comprendre les dynamiques individuelles et de groupe dans la conduite du changement. Dans un contexte où les parties intéressées sont aux prises avec une situation incertaine (leur capacité à prendre soin des rivières et les changements que cela impliquerait), il est nécessaire d’explorer des possibilités de transformation en mobilisant plusieurs méthodes : interviews, observations participantes, pratiques artistiques et ateliers, dans le but de soutenir l’expérimentation sociale et le changement par la mise en œuvre de chantiers citoyens. L’approche de cette RAP incitent les co-chercheurs à repenser et transformer leurs propres pratiques, en concevant de nouvelles méthodes et technologies chemin faisant. Réflexive, la RAP se nourrit et nourrit l’agentivité citoyenne pour prendre soin des rivières au moyen de la médecine castor.
Questions structurantes
Le projet RESTOR, par son ADN-même de projet de co-recherche, est en train de faire émerger les questions de recherche qui intéressent les citoyen·ne·s concernés et les parties prenantes. Toutefois, des questions commencent à émerger à l’observation de cette dynamique :
- Quelle place dans les politiques publiques pour cette nouvelle agentivité citoyenne ?
- Quelle est la légitimité d’un humain à prendre soin des milieux rivières en imitant et à la place des castors ?
- Quelles sont les conditions et incidences foncières et économiques du développement de cette volonté citoyenne ?
- Qu’est-ce qui fonde et qu’est-ce qu’implique cette posture citoyenne de soin au milieu rivière d’un point de vue socioculturel ?
Un premier chantier école
Situé sur la commune de Montaigu-de-Quercy dans le Tarn-et-Garonne, un premier chantier école s’est déroulé mi-juin 2025 sur le ruisseau de Prézan, affluent rive droite de la Petite Séoune. Ce chantier sur un cours d’eau sévèrement incisé vise à le reconnecter avec la plaine alluviale adjacente, à encourager le développement d’un chenal secondaire et à favoriser l’établissement pérenne d’une zone humide aujourd’hui asséchée en période estivale.
La mise en œuvre de ce chantier s’est faite en partenariat avec l’association Théra et le groupe de citoyens concernés, les riverains du Prézan dont un agriculteur, le bureau d’étude Sire Conseil, l’association naturaliste Je suis la Piste !, le MapCa (association Mouvement d’alliance avec le peuple castor), TBS Research Center, avec le soutien du Syndicat mixte du bassin versant des 2 Séoune, et l’autorisation de la DDT 82.
Les photos ci-dessous illustrent deux temps du chantier-école.


Phase d’amorçage
2025 – 2027
Contacts
Joël NAYET (Association Théra) : joel.nayet@protonmail.com
Dr. Charline COLLARD (TBS Research Center – TBS Education) : c.collard@tbs-education.fr
Lien
à venir
Ce document a été réalisé avec l’aide financière de :